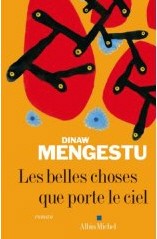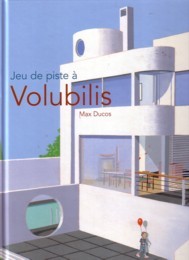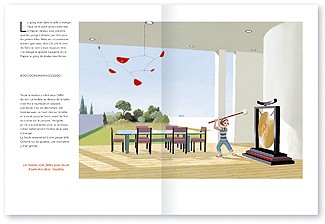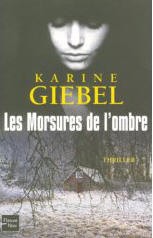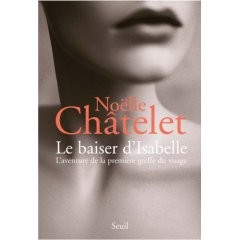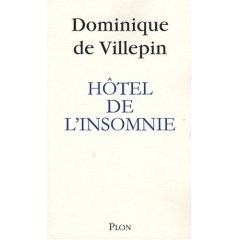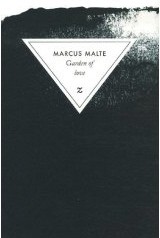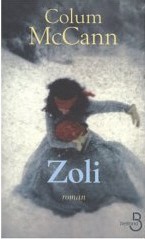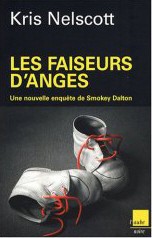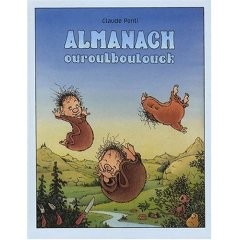Les belles choses que porte le ciel (D. MENGESTU)
Le hasard a voulu qu'à mon retour d'Afrique la sélection du mois de ELLE ait justement ce thème pour deux livres sur trois ! C'est ainsi que j'ai découvert le premier roman de Dinaw MENGESTU, Éthiopien émigré aux États-Unis.
"Le jeune Sépha a quitté l’Éthiopie dans des circonstances dramatiques. Des années plus tard, dans la banlieue de Washington où il tient une petite épicerie, il tente tant bien que mal de se reconstruire, partageant avec ses deux amis, Africains comme lui, une nostalgie teintée d’amertume qui leur tient lieu d’univers et de repères. Mais l’arrivée dans le quartier d’une jeune femme blanche et de sa petite fille métisse va bouleverser cet équilibre précaire… "
Ce roman est d'une grande douceur à la lecture. Le terme peut surprendre mais c'est néanmoins le mot qui s'impose. N'allez pas pour autant imaginer que tout y est joie et bonheur, c'est exactement le contraire. Simplement, la manière de le raconter, la petite musique de MENGESTU est empreinte de mélancolie, de résignation et de langueur. Le personnage de Stépha est d'une grande lucidité sur lui même, sur la condition des déracinés comme lui et sur le monde qui change.
Épicier dans Logan Circle, un quartier autrefois misérable mais qui connaît depuis quelques temps une réhabilitation et une inflation immobilière, Stepha voit passer les gens et les choses, ne pouvant se résoudre à entrer dans la ronde et préférant en rester spectateur. Flanqué de deux amis, africains comme lui, chacun incarne un aspect du déracinement et de la volonté d'intégration. Le constat est amer, pessimiste, il est cependant plein d'humanité.
Ainsi ce passage où Stepha esquisse son autoportrait :
Lorsque mon oncle Berhane m'avait demandé pourquoi j'avais choisi d'ouvrir une petite épicerie dans un quartier noir pauvre alors que rien dans ma vie ne m'avait préparé à ce genre de chose, je ne lui avais jamais dit que c'était parce que tout ce que j'attendais de la vie maintenant, c'était de pouvoir lire tranquillement, seul, le plus longtemps possible dans la journée. Je l'avais quitté, lui et son modeste appartement de trois pièces en banlieue, pour emménager à Logan Circle, une décision qu'il n'a toujours pas comprise et qu'il ne m'a toujours pas pardonnée, quoi qu'il en dise. Il nourrissait les plus grandes ambitions pour moi, lorsque j'étais arrivé d'Ethiopie. "Tu verras, me disait-il toujours de sa voix douce et éloquente, tu seras ingénieur, ou bien médecin. J'aimerais tellement que ton père soit toujours vivant pour voir ça." Les larmes lui montaient parfois aux yeux quand il parlait de l'avenir, qui, il le croyait, ne pouvait qu'être plein de choses meilleures et plus belles. Cela dit, à Logan Circle, je n'avais pas à être quelqu'un de plus grand que ce que j'étais déjà. J'étais pauvre, noir, et portais l'anonymat qui allait avec ça comme un bouclier contre toutes les premières ambitions de l'immigrant, qui m'avaient depuis longtemps déserté, si tant est que je les aie un jour ressenties. De fait, je n'étais pas venu en Amérique pour trouver une vie meilleur. J'étais arrivé en courant et en hurlant, avec les fantômes d'une ancienne vie fermement attachée à mon dos. Mon objectif, depuis lors, avait toujours été simple : durer, sans être remarqué, jour après jour, et ne plus faire de mal à qui que ce soit.
Dinaw MENGESTU, Les belles choses que porte le ciel, 2007.
"Un homme coincé entre deux mondes vit et meurt seul. Ça fait assez longtemps que je vis ainsi en suspension."
D. MENGESTU